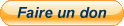Irène de Palacio
4 déc. 2025



Dernière mise à jour : 13 nov. 2025

(1840)
Bagnères-de-Luchon
15 septembre, temps de pluie.
Aujourd’hui je devais aller au port de Venasque et revenir par le port de la Picade, aller en Espagne encore une fois ! Le projet est avorté et je suis à écrire assis sur un canapé d’auberge, en paletot et le chapeau sur la tête. Je ne sais ni que faire, ni que lire, ni qu’écrire. Il faut passer ainsi toute une journée, et qui promet d’être ennuyeuse. À peine s’il est 7 heures du matin, et le jour est si triste qu’on dirait du crépuscule ; il fait froid et humide. Restant confiné dans ma chambre, il ne me reste qu’un parti, c’est d’écrire. Mais quoi écrire ? il n’y a rien de si fatigant que de faire une perpétuelle description de son voyage, et d’annoter les plus minces impressions que l’on ressent ; à force de tout rendre et de tout exprimer, il ne reste plus rien en vous ; chaque sentiment qu’on traduit s’affaiblit dans notre coeur, et dédoublant ainsi chaque image, les couleurs primitives s’en altèrent sur la toile qui les a reçues.
Et puis, à quoi bon tout dire ? N’est-il pas doux au contraire de conserver dans le recoin du coeur des choses inconnues, des souvenirs que nul autre ne peut s’imaginer et que vous évoquez les jours sombres comme aujourd’hui, dont la réapparition vous illumine de joie et vous charmera comme dans un rêve ? Quand je décrirais aujourd’hui la vallée de Campan et Bagnères-de-Bigorre, quand j’aurais parlé de la culture, des exploitations, des chemins et des voitures, des grottes et des cascades, des ânes et des femmes, après ? après ?.. est-ce que j’aurai satisfait un désir, exprimé une idée, écrit un mot de vrai ? je me serai ennuyé et ce sera tout. Je suis toujours sur le point de dire avec le poète :
A quoi bon toutes ces peines,
Secouez le gland des chênes,
Buvez de l’eau des fontaines,
Aimez et rendormez-vous.
Je suis avant tout homme de loisir et de caprice, il me faut mes heures, j’ai des calmes plats et des tempêtes. Je serais resté volontiers quinze jours à Fontarabie, et je n’aurais vu ni les eaux thermales, ni la fabrique de marbre à Bagnères-de-Bigorre, qui ne vaut pas l’ongle d’une statue cassée, ni bien d’autres belles choses qui sont dans le guide du voyageur. Est-ce ma faute si ce qu’on appelle l’intéressant m’ennuie et si le très curieux m’embête ? Hier, par exemple, en allant au lac d’Oo, quand mes compagnons maugréaient contre le mauvais temps, je me récréais de la pluie qui tombait dans les sapins et du brouillard qui faisait comme une mer de blancheur sur la cime des montagnes. Nous marchions dedans comme dans une onde vaporeuse, les pierres roulaient sous les pieds de nos chevaux, et bientôt le lac nous est apparu calme et azuré comme une portion du ciel ; la cascade s’y mirait au fond, les nuages qui s’élevaient du lac, chassés par le vent, nous laissaient voir de temps en temps les sommets d’où elle tombe.
En venant ici de Bagnères-de-Bigorre, nous avons couché à Saint-Bertrand-de-Comminges, vieille petite ville aux rues raides et pierreuses, presque déserte, silencieuse et ouverte au soleil. De la vieille ville romaine il ne reste rien, et de l’église romane peu de chose, tant l’attention se porte ailleurs tout entière. La façade est nue ; grande tour carrée avec du ciment neuf entre les vieilles pierres, couverte d’un chapeau de planches construit récemment pour couvrir les cloches qui se rouillent sans doute. Le portail est petit et de vieux goût roman, et les chapiteaux de ses colonnes supportent des grotesques : gnomes montés sur des hippogriffes, usés par le temps, uniformes d’eux-mêmes et qui semblent rire dans leur horreur du mystère qui les entoure. À l’intérieur, murs simples et nus ; point d’abside ; les fenêtres, hautes et étroites, et sur les côtés des arcades jumelles et pointant en pure ogive diminuent de hauteur à mesure qu’elles s’inclinent vers le fond, comme si l’élan diminuait. Mais ce qui est maintenant toute l’église et ce qui la constitue réellement, c’est un immense jubé en buis qui renferme à lui seul le choeur et la nef, le prêtre et les fidèles. Ses pans hauts obscurcissent le jour qui tombe des fenêtres romanes ; son maîtreautel, plein de fioritures de bois peint, cache la relique du saint qui est relégué derrière, comme dans la coulisse ; sur les parois latérales, à chaque médaillon une tête de chevalier ou de matrone, souvenir antique que le libre caprice du sculpteur a jeté à profusion, plaçant l’art au milieu de la foi, le remplissant et s’en faisant un prétexte. N’est-ce pas l’antiquité dans le roman, le xvie siècle dans le XIe, la Renaissance dans le moyen âge ? Partout le bois est sculpté, fouillé, tressé, tant le talent est flexible, tant l’imagination se joue et rit dans les mignardes inventions ; aux culs-de-lampe ce sont des amours suspendus et versant des corbeilles de fleurs sur des seins de femmes qui palpitent, et des ventres de tritons qui rebondissent et dont, plus bas, la queue de poisson s’enlace et se roule sur la colonne.
Çà et là c’est une tête de mort, plus loin, une face de cheval, de lion, n’importe quoi pourvu que ce soit quelque chose ; ici un pédagogue qui fesse un écolier pour faire rire quand on passe à côté ; la luxure en femme avec le pied fourchu, et la feuille de chou, un singe qui a mis le capuchon d’un moine, des bateleurs qui s’exercent, et mille choses encore sans gravité et sans pensée ; partout de la complaisance dans les formes, de l’esprit, de l’art et rien autre chose ; pas une tête inspirée qui prie, pas une main tendue vers le ciel, ce n’est pas une église, c’est plutôt un boudoir. Dans un temple, toutes ces miséricordes ouvragées où l’on s’assoit comme dans un fauteuil, et où les belles dames du xvie siècle laissaient retomber leurs doigts effilés se prélassant sur les détails païens, ces volutes, ces feuilles d’acanthe, ces têtes de mort même, qu’est-ce que tout cela veut dire ? Les prophètes, les docteurs et les sibylles qui se suivent méthodiquement dans chaque cadre de bois, sur les parois intérieures, où vont-ils ? et pour quoi faire ? On leur tourne le dos, et la tête levée vers le ciel rencontre involontairement les petits plafonds fleuris où l’oeil caresse des formes amoureuses. La Renaissance est là entière avec son enthousiasme scientifique et sa prodigalité de formes, et sa décence exquise dans les nudités où elle s’étudie, dans la corruption. Qu’il y a loin de là aux pieux cynisme du moyen âge ! C’est beau, joli, charmant ; on admire de la tête et non du coeur, enthousiasme frelaté qui s’en va vite ; c’est un musée, un beau morceau d’art qui fait penser à l’histoire, un livre en bois où l’on lit une page du XVIe siècle, pas autre chose.
Si vous voulez du grand et du beau, il faut sortir de l’église et gagner la montagne, vous élever des vallées et monter vers la région des neiges. C’est une belle vie que celle de chasser l’isard ou l’ours, de vivre dans le pays des aigles, d’être haut comme eux et de leur faire la guerre. Quand on va au port de Venasque, on traverse d’abord une grande forêt de frênes et de hêtres qui couvrent deux montagnes qui se regardent face à face. Les ravins ont enlevé des arbres, et font sur le côté opposé à celui où vous marchez comme des chemins qui serpentent en tombant à travers les bois. C’était le matin, et les lueurs du soleil levant dessinaient les ombres des branches sur la mousse et sur les feuilles jonchées par terre ; il avait plu, le chemin était boueux ; la lune blanche remontait dans le ciel. Avant de gravir le plus rude, on s’arrête à l’hospice, grande maison nue au dehors comme au dedans, où nous n’avons vu que les enfants du gardien qui se taisaient en nous regardant. La cuisine est haute et voûtée pour soutenir le poids des avalanches ; des meurtrières dans les murs remplacent les fenêtres, et quand on ferme les auvents il fait nuit.
La fumée sortait en nuages du foyer, et le vent qui venait du dehors passait sur les murs noirs et l’agitait autour de nous sans l’entraîner en se retirant. Des chênes dégrossis, placés devant le feu, servent de bancs et bien des belles voyageuses qui venaient là s’y asseoir au mois d’août, en compagnie, gantées, heureuses d’être dans les montagnes et de pouvoir le dire, ne pensent guère que quelques mois plus tard, sur ces mêmes bancs, dans les nuits d’hiver, viennent s’asseoir aussi, armés et sombres, les contrebandiers et les chasseurs d’ours. On ferme les ouvertures avec du foin et de la paille, la résine éclaire la voûte, et l’arbre brûle dans cet âtre sombre autour duquel sont réunis quelquefois jusqu’à cinquante hommes, montagnards égarés, chasseurs, contrebandiers, proscrits. Tous se rangent en cercle pour se chauffer ; les uns guettent les bruits de pas sur la neige, les autres laissent venir le jour et fument sous le manteau de la cheminée. Je crois qu’on y cause peu, et que le vent qui rugit dans la montagne et qui siffle dans les jointures de la porte y fait taire les hommes ; on écoute, on se regarde, et quoique les murs soient solides on a je ne sais quel respect qui vous rend silencieux.
À partir de l’hospice, la route monte en zigzag et devient de plus en plus scabreuse, ardue et aride. On tourne à chaque instant pour faciliter la montée, et si on regarde derrière soi, on s’étonne de la hauteur où l’on est parvenu. L’air est pur, le vent souffle et le vent vous étourdit ; les chevaux montent vite, donnant de furieux coups d’épaule, baissant la tête comme pour mordre la route et s’y hissent. À votre gauche vous apercevez successivement quatre lacs enchâssés dans des rochers, calmes comme s’ils étaient gelés ; point de plantes, pas de mousse, rien ; les teintes sont plus vertes et plus livides sur les bords et toute la surface est plutôt noire que bleue. Rien n’est triste comme la couleur de ces eaux qui ont l’air cadavéreuses et violacées et qui sont plus immobiles et plus nues que les rochers qui les entourent.
De temps en temps on croit être arrivé au haut de la montagne, mais tout à coup elle fait un détour, semble s’allonger, comme courir devant vous à mesure que vous montez sur elle ; vous vous arrêtez pourtant, croyant que la montagne vous barre le passage et vous empêche d’aller plus avant, que tout est fini, et qu’il n’y a plus qu’à se retourner pour voir la France, mais voilà que subitement, et comme si la montagne se déchirait, la Madaletta surgit devant vous. À gauche toutes les montagnes de l’Auvergne, à droite la Catalogne, l’Espagne là devant vous, et l’esprit peut courir jusqu’à Séville, jusqu’à Tolède, dans l’Alhambra, jusqu’à Cordoue, jusqu’à Cadix, escaladant les montagnes et volant avec les aigles qui planent sur nos têtes, ainsi que d’une plage de l’Océan l’oeil plonge dans l’horizon, suit le sillage des navires et voit de là, dans la lointaine Amérique, les bananiers en fleurs, et les hamacs suspendus aux platanes des forêts vierges.
À voir tous les pics hérissés qui s’abaissent et montent inégalement, les uns apparaissant derrière les autres, tous se pressant, serrés et portés au ciel dans des efforts immenses, on dirait les vagues colossales d’un océan de neige qui se serait immobilisé tout à coup. En longeant la montagne le sentier se rétrécit, et les schistes calcaires sur lesquels on marche ressemblent à des lames de couteaux qui vous offriraient leur tranchant. Quand on est arrivé à la hauteur de la Pigue, on est retourné vers la France que l’on aperçoit dans les nuages et dont les plaines se dressent au loin comme des immenses tableaux suspendus, vous offrant des massifs d’arbres, des vallées qui ondulent, des plaines qui s’étendent à l’infini, spectacle d’aigles que vous contemplez du haut d’un amphithéâtre de 1.500 toises. Dans les gorges des montagnes placées sous nous, des nuages blancs se formaient et montaient dans le ciel ; le vent de la terre les faisait monter vers nous, et quand ils nous ont entourés, le soleil qui les traversait comme à travers un tamis blanc fit à chacun de nous une auréole qui couronnait notre ombre et marchait à nos côtés.