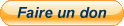Le silence du texte, par Jean de Palacio
- Irène de Palacio

- il y a 14 heures
- 6 min de lecture
"Réfléchir sur le Silence, c’est donc immanquablement réfléchir du même coup sur la compromission du Mot. Sur la présence ou l’absence, sur l’office manqué, sur la promesse non tenue, sur la démission du Mot."

Gauche : Le Silence du texte, Poétique de la Décadence (Jean de Palacio, 2003)
Droite : Le Silence (Lucien Lévy-Dhurmer, 1895)
Entre le Verbe et le Silence, la poésie de la fin du XIXᵉ siècle pressent que parler est déjà trahir. Jean de Palacio explore dans Le Silence du texte cette tension où le mot, loin de révéler l’absolu, en marque au contraire la chute. Dans cet extrait que nous publions sur Anthologia s’esquisse, de Jules Laforgue à Mallarmé, d'Adrien Mithouard à Jean Dominique, une esthétique du langage blessé. La Parole, née du Silence, meurtrit ce dernier à chaque syllabe. Écrire devient alors une forme de double-deuil : celui du Silence perdu, et de la Beauté (Vérité) inaccessible.
La page, la phrase, le mot
Jean de Palacio, Le Silence du texte, Poétique de la Décadence (Peeters, 2003)
[extrait]
"La Beauté, c'est le Silence éternel. Tout notre tapage de passions, de discussions, d'orages, d'art, c'est pour, par le bruit, nous faire croire que le Silence n'existe pas. Mais quand nous retombons las, nous l'écoutons restagner de partout et nous sommes plus tristes, pas assez forts pour un tapage éternel pour nous faire au Silence éternel."¹ Dans cette pensée de Jules Laforgue, où passe comme un écho de Pascal, se joue un double drame pour l'âme prise en tenailles entre tapage et silence : d'une part, l'assimilation de la Beauté au Silence ; de l'autre, l'assimilation de l'art au (vain) bruit. Laforgue rejoint ainsi dans ses posthumes la cohote de ceux qui ont placé le Silence plus haut que la Parole : Ernest Hello, Charles Morice, Léon Bloy, Stéphane Mallarmé.
Deux témoins beaucoup moins notoires pourraient éclairer ce débat, où le Mot se voit d'emblée comme frappé de suspicion. A quelques années de distance, deux recueils poétiques d'obédience mallarméenne contiennent en effet deux poèmes aux titres significatifs : l'un, d'Adrien Mithouard, intitulé "L'Assassinat du Silence"² ; l'autre, du poète belge Jean Dominique, intitulé "Le Poème du Silence"³. Tous deux, presque dans les mêmes termes, mettent en accusation le dire et le danger majeur qu'il fait courir au Silence :
J'aimais, et je ne le disais pas — je souffrais et je ne le disais pas — je pensais et mes pensées se mouraient de la terreur des paroles... [Jean Dominique]
Les paroles de bruit sont vaines. Il a fui.
Des mots qu'il ne dit pas se prononcent en lui.
C'est d'être le marcheur sans verbe, le mensonge
Du Silence penseur qui sait et qui se songe. [Adrien Mithouard]
Tout poème, ou chant (carmen), est appréhendé sous l'espèce de la perte, de la trahison et du meurtre : perte, trahison et meurtre du Silence, ici [Adrien Mithouard], protagoniste, là [Jean Dominique] interpellé. "Toutes les mains ensemble, immobiles, poignardent/Le Silence" [Adrien Mithouard] ; "Chaque fois que je l'appelle, je le tue" [Jean Dominique]. La situation de crise ainsi créée suppose deux principes :
a) l'existence d'une sorte d'état primordial de la création antérieur au Logos, appelé Silence (le "Silence éternel" de Laforgue ou le "divin silence" de Jean Dominique), avant que la Parole ne se constitue et n'existe comme telle ;
b) une conception théologique et "rétributive" du Silence, selon laquelle toute Parole est une faute, une transgression en même temps qu'une agression. "Maintenant, silence, j'ai péché — j'ai péché contre toi et tu me repousses".
De sorte que, par rapport à un Silence primordial, un Absolu avant la Révélation, tout chant ne saurait constituer qu'une décadence, une dévaluation ou une déperdition, sous les espèces de la Révélation et de l'Incarnation (au sens où Léon Bloy parlait de l'"Incarnation de l'Adverbe"). "Ma punition la voici : rien n'existe plus pour moi que ce qui est révélé ; mais ce qui est révélé est imparfaitement pur, ce qui est révélé n'est pas absolu" [Jean Dominique]. Conception rigoureuse du Et Verbum caro factum est, puisque au début (in principio) était, non le Verbe, mais le Silence. Le Verbe n'est que l'avatar ou l'hypostase de la Divinité saisie comme Silence.
Le mot est donc par essence imparfait, approximation, pis-aller, à l'état de balbutiement ("J'ai balbutié" (Jean Dominique)", du côté du RIEN et non du TOUT ("J'ai voulu tout dire [...] et ce faisant, je n'ai rien dit" [Jean Dominique], du côté du sens et non pas au-delà du sens. "Autrefois, l'Absolu était : D'autres parlaient autour de moi. — J'écoutais, enfant que j'étais, et je possédais mes pensées — et je les possédais [...] sans désirer comprendre ni que rien me comprît" [Jean Dominique]. Cette Parole liée au sens constitue une chute, semblable à celle du péché originel. C'est pourquoi le Silence "ne veut s'égarer qu'avec lui-même" [Adrien Mithouard].
L’idée qui se fait jour est celle – mallarméenne ou flaubertienne – du Mot non distinct de la Pensée. Le Silence « sait » et « se songe » lui-même [Adrien Mithouard]. Même l’état d’oraison n’échappe pas à cette malédiction du Révéler et de l’Exprimé : « Alors je ne priais pas Dieu et je portais Dieu dans mon cœur » [Jean Dominique].
On peut en effet parler de malédiction, au sens où Mallarmé évoquait, dans « Le Démon de l’Analogie », des « lambeaux maudits d’une phrase absurde » (La Pénultième est morte), représentant « le reste mal abjuré d’un labeur de linguistique par lequel quotidiennement sanglote de s’interrompre ma noble faculté poétique »⁴. Ce « labeur de linguistique » est sans doute analogue à la voix qui, au début du poème de Jean Dominique, chante ce qui est sans voix, trahissant ainsi en même temps qu’elle glorifie le Silence. À l’inverse, ce dernier, dans le poème d’Adrien Mithouard, réfugié dans quelque « site muet », « songe qu’il se tait » et parvient à court-circuiter la Parole, à demeurer, jusque dans sa mort violente, « sans verbe » et « sans cri ». Faut-il mettre en parallèle l’assassinat du Silence et la mort de la Pénultième, qui anticipe la mort de la Dernière (syllabe), interdisant, par là-même, au Mot d’aller jusqu’au bout de lui-même et affirmant la vanité de ce travail du langage dans la création poétique ? La métaphore musicale utilisée à ce moment par Mallarmé, celle du « son nul » sur la corde tendue d’un instrument oublié, corde finalement cassée, paraît bien être celle du deuil de la Parole. Fréquente à l’époque, elle donne son titre à un recueil d’Émile Bergerat, La Lyre brisée (1903) :
Elle met en pièces sa lyre
Et les sème au courant des eaux⁵.
Mais elle n’est pas l’apanage des « grands genres ». La lithographie de Charles Léandre pour La Folle Chanson de Gabriel Montoya (1899), qui sert d’illustration de couverture au présent volume, met en scène, dans des tons pastels, le baiser de la Muse au Poète au travers d’une lyre dont deux cordes sont brisées, comme happées par une gueule simiesque (babouin ou anthropophage) : belle façon de figurer la poésie, même légère, réduite au silence.
« Il est mort et je chante… » [Jean Dominique]. L’avènement du poème (cinq emplois du verbe « chanter » dans le texte) est fonction de la mort du silence. C’est dire que l’incipit, le premier mot est le signe d’une infirmité. Une même aporie se fait jour chez Jean Dominique et Jules Laforgue : pris entre le tapage éternel et le Silence éternel, entre le « ne pas pouvoir ne plus entendre » (le Silence) et le « ne pas pouvoir entendre », le poète cherche une issue. Peut-être est-elle dans cet au-delà du sens, cet écrire pour soi qui hante la fin du siècle et qu’Adolphe Retté reprochait durement à Mallarmé : « mélodie appréciable pour lui seul », « sonorités verbales qu’il déforme ou qu’il accole à son gré, pour lui seul »⁶, « se faire un public de soi seul »⁷ ; « mots […] par moi seul articulés », dit le « décadent » de Clerget⁸. Chanter est une calamité ou un crime. « Et maintenant je chante… j’ai chanté… qu’ai-je fait ! …» [Jean Dominique] Pour le Silence poignardé, « retenant un mot suprême », l’acte d’écrire n’est ni plus ni moins qu’« ensanglant[er] de la cendre » [Adrien Mithouard].
Réfléchir sur le Silence, c’est donc immanquablement réfléchir du même coup sur la compromission du Mot. Sur la présence ou l’absence, sur l’office manqué, sur la promesse non tenue, sur la démission du Mot. Cette prise de conscience de l’insuffisance de la Parole est un des faits notables de la fin du XIXe siècle.
[...]
Notes :
¹ Jules Laforgue, Mélanges posthumes (Paris, Mercure de France, 1903), pp. 116-117
² Adrien Mithouard, L'Iris exaspéré (Paris, Lemerre, 1895)
³ Jean Dominique [pseud. de Marie Closset], L'Ombre des Roses (Bruxelles, Edition du Cyclamen, 1901), pp. 5-6.
⁴ Mallarmé, Divagations (Paris, Fasquelle, 1897), p. 13.
⁵ Émile Bergerat, La Lyre brisée (Paris, Ollendorff, 1903), « Sonnet titulaire ».
⁶ Adolphe Retté, Aspects (Paris, Bibliothèque de La Plume, 1897), « Le Décadent ».
⁷ Georges Rodenbach, L’Art en exil (Paris, L’Édition Moderne, 1889), p. 116.
⁸ Fernand Clerget, Henry Pivert (Paris, Genonceaux, 1891), p. 189. À noter que Mallarmé apparaît dans ce roman à clefs sous le nom d’Étienne Astraté.