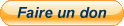Irène de Palacio
4 déc. 2025




(1956)
§ 3. La radio et l'écran de télévision deviennent la négation de la table familiale; la famille devient un public en miniature
(...) Selon un article paru dans le quotidien viennois Presse du 24 décembre 1954, « la famille française a découvert que la télévision était un bon moyen de détourner les jeunes gens de passe-temps coûteux, de retenir les enfants à la maison et de donner un nouvel attrait aux réunions familiales ». Il n'en est rien. Ce mode de consommation permet en réalité de dissoudre complètement la famille tout en sauvegardant l'apparence d'une vie de famille intime, voire en s'adaptant à son rythme. Le fait est qu'elle est bel et bien dissoute : car ce qui désormais règne à la maison grâce à la télévision, c'est le monde extérieur - réel ou fictif - qu'elle y retransmet. Il y règne sans partage, au point d'ôter toute valeur à la réalité du foyer et de la rendre fantomatique - non seulement la réalité des quatre murs et du mobilier, mais aussi celle de la vie commune. Quand le lointain se rapproche trop, c'est le proche qui s'éloigne ou devient confus. Quand le fantôme devient réel, c'est le réel qui devient fantomatique. Le vrai foyer s'est maintenant dégradé et a été ravalé au rang de « container» : sa fonction n'est plus que de contenir l'écran du monde extérieur.
« Les services sociaux, peut-on lire dans un rapport de police rédigé à Londres le 2 octobre 1954, ont recueilli dans un appartement de l'est de Londres deux enfants âgés de un et trois ans laissés à l'abandon. La pièce dans laquelle jouaient les enfants n'était meublée que de quelques chaises cassées. Dans un coin trônait un somptueux poste de télévision flambant neuf. Les seuls aliments trouvés sur place consistaient en une tranche de pain, une livre de margarine et une boîte de lait condensé. » La télévision a liquidé le peu de vie communautaire et d'atmosphère familiale qui subsistait dans les pays les plus standardisés. Sans même que cela déclenche un conflit entre le royaume du foyer et celui des fantômes, sans même que ce conflit ait besoin d'éclater, puisque le royaume des fantômes a gagné dès l'instant où l'appareil a fait son entrée dans la maison : il est venu, il a fait voir et il a vaincu. Dès que la pluie des images commence à tomber sur les murailles de cette forteresse qu'est la famille, ses murs deviennent transparents et le ciment qui unit les membres de la famille s'effrite : la vie de famille est détruite.
(...)
§ 4. En nous retirant la parole, les postes de radio et de télévision nous traitent comme des enfants et des serfs
Nous avons dit que ceux qui sont assis devant l'écran de télévision ne se parlent plus que par hasard - pour autant qu'ils le veulent ou le peuvent encore. Cela vaut désormais également pour les auditeurs de la radio. Eux non plus ne se parlent plus que par mégarde. Ils le veulent Nous avons dit que ceux qui sont assis devant l'écran de télévision ne se parlent plus que par hasard - pour autant qu'ils le veulent ou le peuvent encore. Cela vaut désormais également pour les auditeurs de la radio. Eux non plus ne se parlent plus que par mégarde. Ils le veulent Puisque la parole leur est désormais garantie, livrée toute prête et instillée goutte à goutte dans l'oreille, ils ont cessé d'être des animaux doués de logos, tout comme ils ont cessé, en tant que mangeurs de pain, de se rattacher à l'homo faber.
Désormais, ils ne préparent pas davantage leur propre nourriture linguistique· qu'ils ne cuisent leur propre pain. Les mots ne sont plus pour· eux quelque chose qui se prononce, mais quelque chose qui s'écoute; la parole n'est plus pour eux un acte mais une réception passive. Il est clair qu'ils « possèdent » alors le logos dans un tout autre sens que celui auquel pensait Aristote dans sa définition de l'homme ; ce faisant, ils deviennent des êtres infantiles, au sens étymologique du terme - des enfants qui ne parlent pas encore ... Peu importe dans quelle civilisation et dans quel espace politique a lieu cette évolution vers un être privé de logos : les conséquences en seront nécessairement partout les mêmes. Elle produira un type d'homme qui, parce qu'il ne parle plus lui-même, n'a plus rien à dire; un type d'homme qui, parce qu'il se contente d'écouter, de toujours écouter, n'est qu'un «serf».
Le premier effet de cette limitation est d'ores et déjà perceptible sur ceux qui ne sont plus que des auditeurs. Il se répand dans toutes les sphères linguistiques, rendant la langue plus grossière, plus pauvre, si. bien qu'elle finit par lasser ceux mêmes qui la parlenti. Mais il va bien au-delà : la vie et l'homme deviennent eux aussi plus grossiers et plus pauvres, parce que le « coeur » de l'homme - sa richesse et sa subtilité - perd toute consistance sans la richesse. et la subtilité du discours; car la langue n'est pas seulement l'expression de l'homme, mais l'homme est également le produit de son langage; bref, parce que l'homme est articulé comme lui-même articule, et se désarticule quand il cesse d'articuler.
§ 5. Les événements viennent à nous, nous n'allons pas à eux.
Le traitement auquel est soumis l'homme lui est fourni à domicile, exactement comme le gaz ou l'électricité. Mais ce qui est distribué, ce ne sont pas seulement des produits artistiques tels que la musique ou bien des jeux radiophoniques - ce sont aussi les événements réels. Du moins ceux qui ont été sélectionnés, chimiquement purifiés et préparés pour nous être présentés comme une « réalité », ou tout simplement pour remplacer la réalité elle-même. Il suffit à celui qui veut être au courant, qui veut savoir ce qui se passe ailleurs, de rentrer chez lui, où les événements « sélectionnés pour lui être montrés » ne demandent qu'à jaillir du poste comme l'eau du robinet.
Comment pourrait-il, à l'extérieur, dans le chaos du réel, être en mesure de saisir autre chose que des réalités de portée infime, locale ? Le monde extérieur nous dissimule le monde extérieur. C'est seulement lorsque la porte d'entrée se referme en faisant entendre le déclic de sa serrure que le dehors nous devient visible; c'est seulement une fois que nous sommes devenus des monades sans fenêtres que l'univers se réfléchit en nous; c'est seulement lorsque nous promettons à la tour de rester enfermés entre ses murs au lieu de scruter le monde depuis son sommet que le monde vient à nous, que le monde nous plaît, que nous devenons pareils à Lyncée. [Lyncée était l'un des Argonautes. Sa vue était si perçante qu'elle lui permettait de voir ce qui se passait dans le del et dans les enfers. Ndt]
Au lieu de la pauvre certitude : « Regarde, le bien est si proche », par laquelle nos pères pouvaient répondre à la question : « À quoi bon errer au loin ? », il faudrait aujourd'hui énoncer la certitude suivante : « Regarde, le lointain est si proche », et pourquoi pas celle-ci : « Regarde, il n'y a vraiment plus que le lointain qui nous soit proche. » Nous voilà au coeur du sujet. Car ce sont les événements - les événements eux-mêmes, non des informations les concernant - les matchs de football, les services religieux, les explosions atomiques qui nous rendent visite; c'est la montagne qui vient au prophète, le monde qui vient à l'homme et non l'homme au monde : telle est, après la fabrication de l'ermite de masse et la transformation de la famille en public miniature, la nouvelle réussite proprement bouleversante de la radio et de la télévision.
Notre enquête va maintenant porter sur ce troisième bouleversement. Car elle s'attache presque exclusivement aux altérations singulières que subit l'homme, en tant qu'être auquel on fournit le monde comme on lui fournit gaz et électricité, et aux conséquences non moins singulières que cette livraison du monde à domicile entraîne pour le concept de monde et pour le monde lui-même. Afin de montrer que cela pose de véritables questions philosophiques, voici dans un ordre presque systématique quelques-unes des conséquences que nous serons amenés à envisager au cours de notre enquête.
1. Quand c'est le monde qui vient à nous et non l'inverse, nous ne sommes plus « au monde », nous nous comportons comme les habitants d'un pays de cocagne qui consomment leur monde.
2. Quand il vient à nous, mais seulement en tant qu'image, il est à la fois présent et absent, c'est-à-dire fantomatique.
3. Quand nous le convoquons à tout moment (nous ne pouvons certes pas disposer de lui mais nous pouvons l'allumer et l'éteindre), nous détenons une puissance divine.
4. Quand le monde s'adresse à nous sans que nous puissions nous adresser à lui, nous sommes condamnés au silence, condamnés à la servitude.
5. Quand il nous est seulement perceptible et que nous ne pouvons pas agir sur lui, nous sommes transformés en espions et en voyeurs.
6. Quand un événement ayant eu lieu à un endroit précis est retransmis et peut être expédié n'importe où sous forme d' « émission », il est alors transformé en une marchandise mobile et presque omniprésente : l'espace dans lequel il advient n'est plus son « principe d'individuation ».
7. Quand il est mobile et apparaît en un nombre virtuellement illimité d'exemplaires, il appartient alors, en tant qu'objet, aux produits de série. Il faut payer pour recevoir ce produit de série : c'est bien la preuve que l'événement est une marchandise.
8. Quand il n'a d'importance sociale que sous forme de reproduction, c'est-à-dire en tant qu'image, la différence entre être et paraître, entre réalité et image, est abolie.
9. Quand l'événement sous forme de reproduction prend socialement le pas sur sa forme originale, l'original doit alors se conformer aux exigences de la reproduction et l'événement devenir la simple matrice de sa reproduction.
10. Quand l'expérience dominante du monde se nourrit de pareils produits de série, on peut tirer un trait sur le concept de « monde » (pour autant que l'on entende encore par « monde » ce dans quoi nous sommes). On perd le monde, et les émissions font alors de l'homme un« idéaliste».
* * *