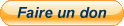Irène de Palacio
4 déc. 2025




Edvard Munch
Self-Portrait with a Bottle of Wine
Deanna L Durben
Comprendre le camouflage autistique : le recours aux discussions communautaires en ligne et à la recherche sur l'identité stigmatisée
"Pour éviter la stigmatisation omniprésente entourant l’autisme, les personnes autistes s’efforcent souvent de paraître neurotypiques en utilisant le camouflage pour dissimuler leurs comportements et traits naturels. Le camouflage peut permettre aux personnes autistes de naviguer plus facilement dans les interactions sociales, mais nous manquons de données empiriques claires sur son efficacité. De plus, le stress et l’épuisement causés par le camouflage semblent être très préjudiciables à la santé mentale. Cette revue examine la nécessité d’élucider les avantages et les inconvénients du camouflage, de comprendre comment les personnes autistes prennent des décisions concernant le camouflage et d’évaluer comment il se compare à d’autres stratégies pour éviter la stigmatisation.
L’autisme est une identité hautement stigmatisée et les personnes autistes sont confrontées à une déshumanisation et une marginalisation généralisées dans la société (Botha et coll., 2022; Pearson et Rose, 2021; Turnock et coll., 2022). La stigmatisation est un attribut discréditant qui réduit le porteur “d'une personne entière et habituelle à une personne corrompue et sous-estimée” (Goffman, 1963, p. 3), favorisant la perte de statut et un sentiment de séparation des groupes non stigmatisés, les personnes stigmatisées étant confrontées à l'ignorance, aux préjugés et à la discrimination aux niveaux interpersonnel et sociétal (Lien et Phelan, 2013).
(...)
La stigmatisation externe entre en collision avec les styles d’interaction sociale atypiques des personnes autistes, ce qui entraîne des niveaux d’intégration sociale plus faibles, un plus grand sentiment de solitude, moins d’amitiés et des taux de victimisation plus élevés, par rapport aux pairs neurotypiques (Botha et Frost, 2020; Turnock et coll., 2022). Les enfants autistes sont plus susceptibles d’être victimes d’intimidation (les estimations du taux de prévalence au cours de la vie varient de 60–94 %), et une vaste étude a révélé qu’au cours d’une période d’un mois, 44–77 % des enfants autistes ont été victimes d’intimidation, contre 2–17 % des enfants au développement normal (Hoover, 2015). Les adultes autistes sont également confrontés à plus de difficultés d’emploi, de difficultés financières et de violences domestiques que les adultes non autistes (Griffiths et coll., 2019), et la prévalence de la violence sexuelle contre les femmes autistes peut être 2–3 fois plus élevée que celle contre les femmes dans la population générale (Cazalis et coll., 2022), qui sont tous des facteurs de stress associés à une qualité de vie réduite. Les personnes autistes intériorisent également des croyances stigmatisantes sur l’autisme, nuisant davantage à leur estime de soi et à leur santé mentale (Han et coll., 2022).
Pour éviter la stigmatisation, les personnes autistes “camouflent” souvent leurs comportements dans le but de dissimuler leur autisme et de passer pour neurotypiques (Bradley et coll., 2021; Perry et coll., 2022). En effet, le degré de stigmatisation dont souffre une personne autiste est directement lié à la mesure dans laquelle elle camoufle ses traits (Perry et coll., 2022; Turnock et coll., 2022). Ainsi, le camouflage est mieux compris comme un mécanisme d’autoprotection qui se développe en réponse à son environnement social et à ses normes collectives (Pearson et Rose, 2021).
Le camouflage autistique est un domaine d’étude académique relativement nouveau ; Hull et coll. (2017) ont été les premiers à créer un modèle conceptuel complet de camouflage, en se concentrant sur ses motivations, ses techniques et son impact. Auparavant, les chercheurs avaient examiné le camouflage principalement comme une explication potentielle des différences entre les sexes dans les taux de diagnostic et les présentations externes de l'autisme, car les femmes se camouflent généralement davantage (Bargiela et coll., 2016; Dean et coll., 2017; Hull et coll., 2017; Hull et coll., 2020; Lai et coll., 2011; Lai et coll., 2017), plutôt que comme son propre phénomène. Par conséquent, ses mécanismes, sa trajectoire de développement, ses effets et ses conséquences à long terme n’ont pas encore été examinés en profondeur et aucune étude longitudinale n’a été menée. Cependant, des études qualitatives et quantitatives récentes trouvent systématiquement les mêmes motivations pour le camouflage, ce qui suggère qu’il s’agit d’un phénomène robuste et courant. Ces raisons sont centrées sur l’intégration et le passage dans un monde neurotypique, l’évitement du rejet et de l’intimidation et la réussite de la formation de liens sociaux (Cage et Troxell-Whitman, 2019; Hull et coll., 2017, 2019; Perry et coll., 2022).
Le camouflage implique l’utilisation de stratégies comportementales et cognitives spécifiques pour dissimuler son autisme (Cook et coll., 2021). Cela comprend l'imitation de comportements neurotypiques tels que le contact visuel, la mémorisation de règles et d'indices sociaux non intuitifs et l'apprentissage conscient de scripts conversationnels “utiles” (Cook et coll., 2021; Davidson et Henderson, 2010; Hull et coll., 2017). Les personnes autistes peuvent assumer un rôle déférent dans les interactions et centrer leur interlocuteur afin de réduire la quantité de parole qu'elles doivent prononcer (Cook et coll., 2022; Hull et coll., 2017). Le camouflage implique également la suppression des comportements associés à l'autisme tels que les stimulations motrices répétitives, l'écholalie et les réactions négatives aux stimuli sensoriels afin de paraître “normaux” (Davidson et Henderson, 2010).
Par exemple, une personne autiste hypothétique, Alice, pourrait prendre ces mesures lorsqu’elle rencontre une nouvelle personne : Alice affiche un grand sourire et élève délibérément la voix vers le haut pour démontrer son enthousiasme tout en disant bonjour, car son ton monotone naturel est souvent perçu comme du désintérêt. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait pour s'amuser, Alice répond par une réponse pratiquée en deux phrases et redirige rapidement la conversation pour se concentrer sur l'autre personne ; elle ne veut pas révéler l'intensité atypique de ses intérêts particuliers à un inconnu, et elle a lu que d'autres personnes ressentiront plus positivement une interaction lorsqu'elles pourront parler d'elles-mêmes. De plus, il est plus facile de paraître socialement compétente dans un rôle d’écoute, où elle sourit, fait des réactions appropriées et maintient le contact visuel malgré son inconfort.Il est plus difficile d’exécuter correctement ces comportements non verbaux lorsqu’elle doit également se concentrer sur la décision de ce qu’elle doit dire. Tout au long de l'interaction, Alice serre les dents et lutte contre l'envie de grimacer ou de se plaindre de la façon dont les lumières fluorescentes font un bourdonnement ; elle sait par expérience que personne d'autre n'est dérangé et elle ne veut pas attirer l'attention sur les différences entre eux.
Il n’existe pas de données claires sur le succès du camouflage, car les opérationnalisations du camouflage varient et la plupart des mesures sont en cours de développement préliminaire avec des propriétés psychométriques incertaines (Fombonne, 2020; Hannon et coll., 2023). Les mesures de divergence tentent de calculer l'écart entre les traits autistiques naturels d'une personne et sa présentation comportementale externe, tandis que les méthodes d'observation/réflexion s'appuient sur les descriptions autodéclarées du camouflage par les participants’ (Hannon et coll., 2023). Bien que des preuves préliminaires suggèrent que les deux méthodes mesurent avec succès le même construit, des recherches supplémentaires sont nécessaires (Hannon et coll., 2023).
Des résultats antérieurs démontrent que le camouflage peut souvent permettre aux personnes autistes d’apparaître suffisamment “normales” pour être cliniquement négligées. Ce n'était pas until 2022 que le DSM a reconnu que les compétences acquises comme le camouflage peuvent avoir un impact sur la présentation externe d'une personne, ajoutant que “les symptômes actuels peuvent être masqués par des mécanismes compensatoires” aux critères diagnostiques (APA, 2022, p. 36). De nombreuses personnes autistes, en particulier les femmes, ont échappé à la détection des parents et des pédiatres travaillant sur la base de stéréotypes dépassés sur l’autisme et sont restées non diagnostiquées jusqu’à l’âge adulte ou au-delà (Cage et Troxell-Whitman, 2019; Hull et coll., 2020).
Cependant, il n’est pas clair si le camouflage permet aux personnes autistes de “passer” pleinement pour neurotypiques et d’atteindre le lien social qu’elles désirent. Une étude menée auprès d’enfants d’école primaire a révélé que les filles autistes peuvent obtenir l’apparence superficielle d’une interaction sociale réussie en se camouflant, mais n’acquièrent pas réellement d’amitiés profondes ni d’engagement social soutenu (Dean et coll., 2017). Lors des entretiens, les adultes autistes suggèrent que le camouflage ne cache pas complètement leur autisme, mais les aide néanmoins à s'intégrer et à communiquer avec succès, en particulier lors d'interactions formelles qui peuvent être préparées à l'avance, comme les entretiens d'embauche et les premiers rendez-vous (Bradley et coll., 2021; Hull et coll., 2017). L’efficacité du camouflage varie probablement considérablement selon le contexte et selon la personne et doit être étudiée plus en détail.
Bien que le camouflage puisse être un mécanisme utile permettant aux personnes autistes de naviguer dans les situations sociales et de réduire la discrimination externe à laquelle elles sont confrontées, ces avantages peuvent être contrebalancés par le stress lié à la dissimulation de leur identité. Le camouflage a des effets très néfastes sur la santé mentale, notamment l’épuisement, l’anxiété, la dépression et la perte d’identité (Bradley et coll., 2021; Cage et Troxell-Whitman, 2019; Cage et coll., 2018; Cassidy et coll., 2020; Cook et coll., 2021; Hull et coll., 2020; Perry et coll., 2022). Le camouflage entraîne des taux plus élevés de comportements suicidaires et de suicidalité au cours de la vie chez les personnes autistes et explique en partie pourquoi le taux de suicide autiste est 7,5 fois plus élevé que dans la population générale (Cassidy et coll., 2020). Dans une population où les taux d’incidence de l’anxiété clinique et de la dépression sont supérieurs à 50 %, soit plus du double de ceux de la population générale, le lien entre camouflage et problèmes de santé mentale est particulièrement troublant (Hirvikoski et coll., 2016; Kirsch et coll., 2020).
Contrairement à la gestion des impressions (mettre en valeur ou minimiser des aspects du soi pour présenter la meilleure impression extérieure), le camouflage autistique tente de dissimuler complètement son “vrai soi” (Pearson et Rose, 2021) et est beaucoup plus éprouvant émotionnellement (Bargiela et coll., 2016; Hull et coll., 2017). Jouer constamment un rôle distinct de son comportement naturel rend encore plus difficile de se sentir en sécurité et de suivre son identité authentique, ce qui a des conséquences incroyablement lourdes (Cassidy et coll., 2020; Hull et coll., 2017). Naviguer dans un environnement social déroutant en utilisant des stratégies conscientes provoque un épuisement élevé et est mentalement, physiquement et émotionnellement épuisant (Bradley et coll., 2021; Hull et coll., 2017). Le camouflage nécessite une concentration intensive, une maîtrise de soi et une gestion de l'inconfort ; les personnes autistes déclarent avoir besoin de temps seules pour récupérer ou “être elles-mêmes” à nouveau après des interactions sociales, et ressentent des pics d'anxiété et de stress en devant à la fois surveiller et surveiller les autres simultanément (Bradley et coll., 2021; Hull et coll., 2017).
Il est important de noter que le camouflage fréquent est associé à un sentiment d’appartenance contrarié – un sentiment de manque d’acceptation dans ses cercles sociaux et dans la société (Cassidy et coll., 2020). L’appartenance contrariée peut être mesurée par la solitude autodéclarée et le manque de soutien social, et est fortement liée à l’expérience ingénue et forcée du camouflage (Cassidy et coll., 2020). Certaines personnes avaient l’impression que les relations qu’elles nouaient en se camouflant étaient basées sur la tromperie et étaient donc fallacieuses, renforçant le sentiment d’isolement et d’incompréhension, ainsi que la culpabilité d’avoir potentiellement trompé leurs amis et même leurs proches.
À la lumière des preuves selon lesquelles le camouflage a un impact négatif sur la santé mentale, il est particulièrement important d’élucider ses avantages et de déterminer dans quelle mesure il s’agit d’une stratégie nécessaire ou viable pour les personnes autistes. Comme détaillé ci-dessus, nous manquons actuellement d’une compréhension complète de l’efficacité du camouflage, en termes de savoir si et quand il permet aux personnes autistes de naviguer avec succès dans les interactions sociales et d’éviter la stigmatisation/discrimination.
De plus, nous avons découvert des associations entre le camouflage et la suicidalité, la dépression, l’anxiété et la solitude, mais nous n’avons pas encore établi de causalité ni déterminé si ces effets diffèrent en fonction du contexte et de l’environnement.Nous devons chercher à comprendre comment les personnes autistes prennent des décisions concernant le camouflage et comment les comportements de camouflage se développent au fil du temps et sont façonnés par la pression sociétale et interpersonnelle (Pearson et Rose, 2021). En jetant un filet plus large, nous devrions également examiner comment le camouflage affecte les perceptions de stigmatisation d’une personne autiste et les attitudes de sa communauté, de sa famille, de ses amis et des autres personnes avec lesquelles elle interagit.
(...)"