Alphonse Daudet : Les salons ridicules
- InLibroVeritas

- 13 mai 2023
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 juin 2024
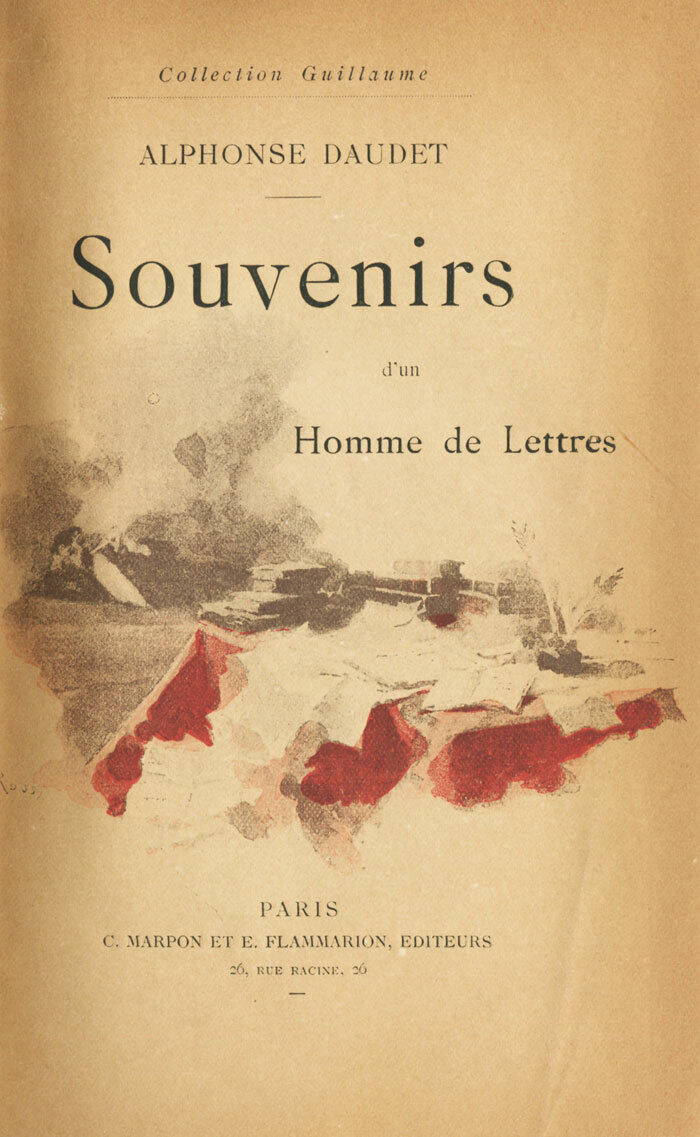
Alphonse Daudet
Souvenirs d’un homme de lettres
Marpon et Flammarion, 1889
NOTES SUR PARIS
LES SALONS RIDICULES
De toutes les folies du temps, il n’y en a pas de plus gaie, de plus étrange, de plus fertile en surprises cocasses, que cette rage de soirées, de thés, de sauteries qui sévit d’octobre en avril à tous les étages de la bourgeoisie parisienne. Même dans les plus modestes ménages, aux coins les plus retirés de Batignolles ou de Levallois-Perret, on veut recevoir, avoir un salon, un jour. Je connais des malheureux qui s’en vont chaque lundi prendre le thé rue du Terrier-aux-Lapins.
Passe encore pour ceux qui ont un intérêt quelconque à ces petites fêtes. Ainsi les médecins qui s’établissent et veulent se faire connaître dans le quartier, les parents sans fortune qui cherchent à marier leurs filles ; les professeurs de déclamation, les maîtresses de piano recevant une fois par semaine les familles de leurs élèves. Ces soirées-là sentent toujours un peu la classe, le concours. Il y a des murs nus, des sièges raides, des parquets cirés, sans tapis, une gaîté de convention et des silences si attentifs quand le professeur annonce : « Monsieur Edmond va nous réciter une scène du Misanthrope », ou « Mademoiselle Élisa va jouer une Polonaise de Weber ».
Mais à côté de cela, combien de malheureux qui reçoivent sans raison, sans profit, simplement pour le plaisir de recevoir, de se bien gêner une fois la semaine et de réunir chez eux une cinquantaine de personnes qui s’en iront en ricanant. Ce sont des salons trop petits, tout en longueur, où les invités, assis et causant, ont l’attitude gênée de gens en omnibus ; des appartements transformés, bouleversés, avec des couloirs, des portières, des paravents à surprises, et la maîtresse de maison effarée qui vous crie : « Pas par là ! »
Quelquefois une porte indiscrète s’entr’ouvre et vous laisse apercevoir là-bas, dans un fond de cuisine, Monsieur qui rentre harassé de courses, trempé de pluie, essuyant son chapeau avec un mouchoir, ou dévorant à la hâte un morceau de viande froide sur une table encombrée de plateaux. On danse dans des corridors, dans des chambres à coucher toutes démeublées, et, en ne voyant plus rien autour de soi que des lustres, des bras de bronze, des tentures, un piano, on se demande avec terreur : « Où coucheront-ils ce soir ? »
J’ai connu dans ce genre une maison très singulière, où les chambres en enfilade, séparées chacune par deux ou trois marches, figuraient des paliers d’étage, si bien que les invités du fond paraissaient grimpés sur une estrade, et, de là, humiliaient les derniers arrivés, rapetissés, enfoncés jusqu’au menton dans les bas-fonds de la première pièce. Vous pensez si c’était commode pour danser. N’importe ! Une fois par mois, il se donnait là une grande soirée. On faisait venir les divans d’un petit café d’en face, et avec les divans un garçon en escarpins, en cravate blanche, le seul des invités qui eût une chaîne et une montre en or. Il fallait voir la maîtresse de maison affolée, décoiffée, toute rouge de tant de préparatifs, courir après cet homme, le poursuivre de pièce en pièce en l’appelant : « Monsieur le garçon… Monsieur le garçon !… »
Et le public de ces soirées-là ! Ce public toujours le même qu’on rencontre partout, qui se connaît, se cherche, s’attire. Tout un monde de vieilles dames et de jeunes filles à toilettes ambitieuses et fanées ; le velours est en coton, la percaline joue la soie, et l’on sent que toutes ces franges défraîchies, ces fleurs chiffonnées, ces rubans passés, ont été bâtis, assortis à la diable avec cette phrase audacieuse : « Bah ! le soir ça ne se verra pas. » On se couvre de poudre de riz, de faux bijoux, de dentelles menteuses : « Bah ! le soir ça ne se verra pas… » Les rideaux n’ont plus de couleur, les meubles s’éraillent, les tapis s’effrangent. « Bah ! le soir… » Et c’est comme cela qu’on peut donner des fêtes et qu’on a la gloire, à trois heures du matin, de voir quatre fiacres, attirés par l’éclat des bougies, s’arrêter devant la porte ; ce qui, du reste, ne sert pas à grand’chose, car en général tout ce monde s’en va à pied, faisant, à des heures impossibles, toute la longue traite de l’omnibus absent, les jeunes filles au bras des pères, les souliers de satin enfoncés dans les socques.
Oh ! Que j’en ai vu de ces salons comiques ! Dans quelles soirées bizarres j’ai promené mon premier habit, alors que, provincial naïf, ne connaissant la vie que par Balzac, je croyais de mon devoir d’aller dans le monde ! Il faut avoir comme moi roulé deux hivers de suite aux quatre coins du Paris bourgeois pour savoir jusqu’où peut aller cette démence des réceptions quand même. Tout cela est un peu vague dans ma mémoire : pourtant je me souviens d’un petit appartement d’employé, un salon tout biscornu où l’on était obligé, pour gagner de la place, de mettre le piano devant la porte de la cuisine. On posait les verres à sirop sur les cahiers de musique et quand on chantait des romances attendrissantes, la bonne venait s’accouder sur le piano pour écouter. Comme elle était prisonnière dans la cuisine, cette malheureuse bonne, c’est Monsieur qui se chargeait du service extérieur. Je le vois encore, tout grelottant dans son habit noir, remonter de la cave avec d’énormes blocs de charbon de terre enveloppés dans un journal. Le papier crève, le charbon roule sur le parquet, et pendant ce temps on continue à chanter au piano : « J’aime entendre la rame, le soir, battre les flots. »
Et cette autre maison, ce cinquième étage fantastique où le carré servait de vestiaire, la rampe de porte-manteau, où les meubles dépareillés s’entassaient tous dans une pièce unique, la seule qu’on pût éclairer et chauffer, ce qui ne l’empêchait pas de rester obscure et glacée malgré tout, à cause de l’abandon, de la misère qu’on sentait rôdant tout autour dans le désert des pièces vides. Pauvres gens ! vers onze heures, ils vous demandaient bien naïvement : « Avez-vous chaud ?… Voulez-vous vous rafraîchir ?… » et ils ouvraient les fenêtres toutes grandes pour laisser entrer l’air du dehors en guise de rafraîchissement.
Après tout, cela valait mieux encore que les sirops à couleurs vénéneuses, les petits-fours poussiéreux conservés si soigneusement d’une semaine à l’autre. N’ai-je pas connu une maîtresse de maison qui, chaque mardi matin, mettait à sécher sur sa fenêtre des petits paquets de thé mouillé, qu’elle faisait resservir deux ou trois lundis de suite ? Oh ! quand les bourgeois se mêlent d’être fantaisistes, on ne sait jamais où ils s’arrêteront. Nulle part, même en pleine bohème, je n’ai rencontré de types aussi bizarres que dans ces milieux-là.
Je me rappelle une dame en blanc, que nous appelions la dame aux gringuenotes, parce qu’elle se plaignait toujours en soupirant d’avoir des gringuenotes dans l’estomac !… Personne n’a jamais su ce qu’elle voulait dire.
Et cette autre, une grosse mère, mariée à un répétiteur de droit, qui amenait toujours avec elle pour la faire danser des élèves de son mari, tous étrangers, un Moldave entortillé de fourrures, un Persan à grande jupe.
Et ce Monsieur qui mettait sur ses cartes « touriste du monde », pour dire qu’il avait fait le tour du monde !
Et, dans un salon de parvenus, cette vieille paysanne aux trois quarts sourde et idiote, toute fagotée dans sa robe de soie, à qui sa fille venait dire en minaudant : « Maman, M. un tel va nous réciter quelque chose. » La pauvre vieille s’agitait sans comprendre sur sa chaise, avec un sourire niais, effaré : « Ah ! bien… bien… » C’est dans cette même maison qu’on avait la spécialité des parents de grands hommes. On vous annonçait en grand mystère : « Nous aurons ce soir le frère d’Ambroise Thomas », ou bien encore « un cousin de Gounod », ou « la tante de Gambetta ». Jamais Gambetta ni Gounod, par exemple. C’est encore là… mais je m’arrête, la série est inépuisable.













