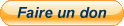Irène de Palacio
4 déc. 2025




« Être différent » est une expression à la mode, qu’on entend beaucoup dans les films américains. « Il faut l’aimer car il est différent », « il faut l’accepter même s’il est différent » sont sans doute, avec leur corollaire « nous sommes une famille », les propos qui reviennent le plus souvent dans les dialogues des comédies ou tragicomédies fabriquées outre-
Atlantique. Ils révèlent à la fois le besoin vital de s’individualiser dans un monde qui tend à la globalisation, à l’uniformité, à la pensée unique et aux mots d’ordre, et la difficulté que rencontrent ceux qui ne pensent pas, n’agissent pas ou n’existent pas de la même façon que la grande majorité des hommes et des femmes qui les entourent.
La différence peut être perçue comme un avantage ou un handicap, selon la réaction du monde extérieur, et surtout celle de l’individu dans son rapport avec celui-ci. Si le monde extérieur juge, la personne qui se sent différente émet elle-même un jugement sur cette différence. Quelqu’un de très grand peut marcher le dos courbé dans l’espoir de faire oublier sa taille ou choisir d’embrasser une carrière de basketteur ou de mannequin ! De la
même manière, lorsque la différence est d’ordre intellectuel, la personne concernée peut tout autant choisir de la cacher pour ne pas heurter le groupe et mieux s’y intégrer, ou l’utiliser pour accéder à des formations de haut niveau.
C’est donc bien ce que l’individu « différent » associe à sa différence qui pèse sur son comportement général, sur son rapport avec le monde, donc sur le chemin qu’il emprunte. Ce ressenti déterminera en grande partie ses choix de vie, et ce d’autant plus que cette différence sera tolérée ou non par la société dans laquelle il évolue. Ainsi, être noir, homosexuel ou femme n’a rien de négatif en soi. Mais ces caractères peuvent devenir discriminants en fonction du jugement que le milieu porte sur eux, même si l’individu
différent n’est jamais tenu d’épouser les préjugés ambiants. Mais nous avons tous appris, dans notre enfance, à mettre des étiquettes sur les autres.
Dès la moyenne section de maternelle, on demande à l’enfant de trouver « l’intrus ». En grande section, il doit identifier « le même » parmi une série d’éléments voisins. Quand il entre à l’école primaire, chaque individu sait donc comparer, inclure et exclure. On connaît la cruauté permanente du groupe pour celui qu’il a catalogué comme intrus. On mesure, à l’aune de la peine éprouvée, le poids de la différence dans la vie d’un homme ou d’une
femme… Et même si, en vieillissant, hommes et femmes s’insensibilisent au regard que les autres portent sur leurs particularités, il n’en reste pas moins que beaucoup de souffrances et d’inhibitions ont déjà réduit leurs choix et bouché leur horizon.
Celui qui est différent apprend très tôt, souvent dans la plus grande solitude, à se protéger psychiquement des difficultés intimes qu’il rencontre. Certains vont de l’avant et réussissent. D’autres mettent au point un clivage entre, d’une part, leur personnalité profonde et les valeurs auxquelles elle est attachée, et, d’autre part, une personnalité d’apparence, sorte de masque qu’ils revêtent pour se mettre à l’abri et s’intégrer. D’autres encore ont recours à l’autodérision pour se faire accepter et écartent systématiquement les questions gênantes qui pourraient mettre en cause leur « normalité ». Mais ces contournements ne changent rien à leur situation : quoi qu’ils fassent, ils seront toujours différents.
La différence que j’évoque n’est pas une impression vague née d’une difficulté à s’adapter au monde, encore moins d’une pathologie psychologique. Elle est celle d’une population particulière, que j’appelle les surdoués adultes. Elle est quantifiée par une série de tests dont nous parlerons un peu plus loin dans cet ouvrage. Elle induit un mal-être caractéristique chez l’adulte surdoué, sur lequel nous reviendrons aussi, et d’année en année, s’il n’est pas corrigé, entraîne un abattement, une aboulie, voire un comportement dépressif qui conduisent à l’échec affectif, social et professionnel. Le danger est d’autant plus grave que la diversité est exacerbée par une société qui, paradoxalement, la supporte de moins en moins à mesure qu’elle l’érige en droit et la marginalise, l’excluant ainsi de plus en plus.
De fait, parallèlement aux voix, toujours plus nombreuses, qui aujourd’hui se font entendre pour revendiquer le droit de penser, d’agir ou de vivre différemment, la société fabrique des anticorps de plus en plus puissants pour stigmatiser et rejeter ceux qu’elle réduit à leur altérité. Et lorsque l’adulte surdoué cumule, avec son QI hors norme, une autre différence – parce qu’il est homosexuel, femme ou étranger –, alors l’« autre » qu’il incarne aux yeux de la masse, cet « autre devient le purement autre, le rien qu’autre, le seulement autre », pour reprendre l’expression du psychologue Claude Geets dans « La peur de la différence». Les deux différences cumulées amplifient la souffrance : à l’extrême intelligence s’associe l’extrême lucidité et, de là, une très grande vulnérabilité, deux sources majeures de fragilité psychique. L’intense personnalité de l’adulte surdoué, sa complexité et sa capacité à se motiver peuvent sommeiller, être bâillonnées, contenues, mais elles ne meurent jamais. Il reste différent « quantitativement » et « qualitativement ».
Chaque individu tend à la différence et défend sa singularité, que ce soit par sa manière d’être, de vivre ou de s’habiller. Chacun marche, comme un funambule, en équilibre sur cette ligne qui distingue la peur de perdre son moi, de se fondre, de se confondre avec la foule anonyme, et celle d’être exclu, rejeté, voire banni par la communauté des êtres humains qui l’entourent. Pour les adultes surdoués, le fil est ténu. Leur tentation est grande de confondre « différent » et « anormal ». Infranchissables pour certains d’entre eux, les frontières avec « le commun des mortels » se sont brouillées pour beaucoup d’autres. Le mal naît souvent d’une impossibilité à définir quelle forme de pensée est la sienne, une interdiction de se poser enfin la question « Qui suis-je ? », d’approcher même l’hypothèse qu’il pourrait être cet adulte doué d’une intelligence aiguisée, plus efficiente que celle des autres.
Le plus grand nombre des adultes dotés d’une surefficience intellectuelle, quand ce diagnostic leur est confirmé, le réfutent d’ailleurs dans un premier temps. Surdoué, pour eux, ne s’applique qu’aux enfants et, comme l’innocence, ce talent doit passer avec l’âge. Ils pensent aussi, comme beaucoup, que l’adulte surdoué le manifeste dans une réussite exceptionnelle, sanctionnée par une carrière universitaire éblouissante, par un triomphe dans les domaines les plus réservés, tels ceux des mathématiques, de la physique ou de l’entreprise de haut niveau. Et pourtant, il suffit qu’il pose cette hypothèse et qu’il la vérifie, et tout l’écheveau d’interdits, d’incompréhensions, de culpabilité qui le noue depuis son enfance se défait. Il comprend alors qu’il lui faut accepter ce qui fait sa différence, et tolérer les délices et les amertumes de son intelligence. Les délices, c’est ce qu’il a toujours rêvé, dans le secret quelquefois enfoui au plus profond de sa mémoire, de devenir ou de réaliser un jour. L’amertume, c’est le constat qu’une grande intelligence, si elle est applaudie et acclamée dans la théorie, est piétinée, contestée et souvent haïe dans la vie quotidienne. Mais c’est elle, comprise, travaillée, épanouie, qui lui permettra justement de s’adapter à ces obstacles.
Nous le verrons aussi, la différence n’est pas seulement source de maux. Dès lors que le surdoué comprend qu’elle n’est pas un handicap mais peut être un véritable atout et permettre de jeter les bases de l’excellence, sa vision sur le monde se transforme. Bien sûr, il y a, et il y aura toujours, sur le parcours de tout adulte surdoué des individus incapables de comprendre l’originalité et la richesse de cette personnalité, et, partant, déterminés à lui mettre des bâtons dans les roues. S’il ne possède pas les recettes ni les aptitudes pour gérer et répondre à ce type d’opposition, le surdoué peut alors renoncer à lui-même, à son épanouissement, développer un certain dépit. Il a trop fait l’expérience des vagues que suscite son désir de s’impliquer pour améliorer ou modifier une situation ; il s’est souvent fatigué du dilemme auquel il est constamment confronté : se faire remarquer en exposant ses idées, ou se taire et se fondre dans la masse. Mais s’il réalise combien cette différence est un atout, combien il doit utiliser ses forces pour la travailler et non pas les gaspiller à la contourner et à occulter ce qui le rend unique, alors il ressaisira sa vie et deviendra enfin, selon l’expression de Nietzsche, « celui qu’il est ».
Encore faut-il que ces adultes sachent qu’ils sont « surdoués », ou mentalement surefficients. Or la plupart n’ont pas été testés dans leur enfance. Comme ils ignorent leur « surdouance », lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou connaissent des échecs répétés dans leur vie d’homme ou de femme, ils sont enclins à se mésestimer et à se dévaloriser, voire à se culpabiliser et à se mortifier.
Il faut savoir que la surdouance ne disparaît ni ne diminue avec l’âge. Elle aurait plutôt tendance à s’accroître et, avec elle, les caractéristiques qui la rendent tellement inadaptable à une vie en communauté. Ainsi, l’hypersensibilité et le perfectionnisme s’intensifient. Et si elles ne trouvent pas d’exutoire, ou même d’explication rationnelle dans le diagnostic établi de leur surefficience intellectuelle, ces particularités sont vécues comme des tares et aggravent l’isolement et l’enfermement. On ne compte plus le nombre d’individus surdoués qui consultent parce que leurs proches leur ont conseillé « de voir quelqu’un » et qui, mal diagnostiqués, voient leurs singularités traitées comme des troubles du comportement !
Dans la même logique, les adultes surdoués ont tendance à regarder leurs propres capacités comme naturelles, alors qu’ils reconnaissent comme brillants ceux qui ont des aptitudes différentes des leurs. En bref, ils se sentent différents, n’en saisissent pas la cause, et souffrent. Comme l’a écrit Emmanuel Kant à propos de ces êtres dotés d’une intelligence très supérieure : « Celui qui y est destiné se pénètre spontanément d’un esprit de modestie ; de la méfiance envers ses propres talents qui consiste à ne pas décider seul, mais à prendre en considération le jugement des autres. »
L’aide première que peut dès lors apporter un clinicien, dans ses consultations, une fois le diagnostic de la surdouance confirmé, c’est d’établir avec le consultant un tableau des différences qui le singularisent, pour qu’il saisisse enfin combien elles sont « pertinentes » dans la construction de sa vie et la réalisation de ses projets ; c’est aussi de lui faire prendre conscience combien l’insertion a un prix, parfois exorbitant, et repérer les écueils et les difficultés qui peuvent, à long terme, induire frustration, anxiété et colère. Bref, lui offrir enfin l’opportunité d’observer, avec acuité, le portrait-robot de son double – celui de l’adulte surdoué –, différent autant qu’il l’est, et apprendre ainsi à se connaître.